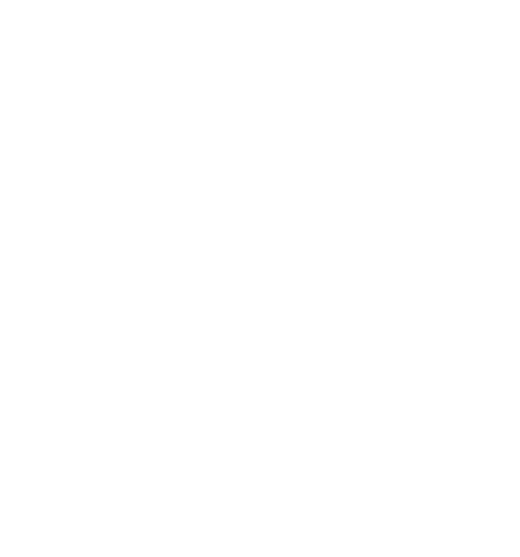Présentation
RÉSUMÉ
La gestion des infrastructures urbaines met l'accent sur la construction et l'entretien des ouvrages d'écoulement des eaux usées et pluviales, nécessitant des conceptions hydrauliques et techniques précises pour divers contextes. Les types de réseaux (unitaires, séparatifs, pseudo-séparatifs) ont des exigences spécifiques demandant une gestion rigoureuse.
Le développement durable est essentiel, notamment via des systèmes de rétention et de déviation comme les bassins de retenue et les déversoirs d'orage pour prévenir les inondations. Face aux défis de l'urbanisation et du changement climatique, des techniques de gestion alternative des eaux pluviales (GAEP), telles que les surfaces perméables et la végétalisation des toitures, réduisent les volumes d'eaux à traiter et améliorent la recharge des nappes phréatiques.
Les infrastructures doivent respecter des normes, utiliser des matériaux de haute qualité et contribuer à la résilience urbaine. Les formes des ouvrages, comme les canalisations circulaires ou ovoïdes, sont choisies en fonction du débit attendu et des conditions de construction, influençant l'efficacité et la durabilité des systèmes. Des formules et méthodes variées assurent des dimensions appropriées et une gestion efficace des débits, avec des techniques modernes de curage et des innovations en conception permettant une maintenance optimale.
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleAuteur(s)
-
Jean-Marc BERLAND : Docteur en sciences et techniques de l’Environnement de l’École Nationale des Ponts et Chaussées – Chef de projet sénior à l’Office International de l’Eau – Limoges – France
INTRODUCTION
Dans le domaine de la gestion des infrastructures urbaines, la construction et l’entretien des ouvrages d’écoulement tiennent une place prépondérante. Ces ouvrages, essentiels pour garantir une évacuation efficace des eaux usées et des eaux pluviales, reposent sur des principes hydrauliques complexes et sur des choix techniques précis pour s’adapter à divers contextes environnementaux et urbains. Leur conception doit répondre à des exigences variées, allant de la prise en compte des débits attendus à la gestion des conditions de construction et d’entretien, en passant par l’optimisation de la forme et du matériau des canalisations. Ces éléments déterminent non seulement leur durabilité, mais aussi leur efficacité à long terme.
Il est essentiel de prendre en compte les particularités des réseaux unitaires, séparatifs ou pseudo-séparatifs lors de la conception et du calcul des ouvrages d’écoulement. Chaque type de réseau a ses spécificités hydrauliques et ses exigences d’entretien qui doivent être scrupuleusement respectées pour éviter des problèmes d’opération et maximiser la durée de vie des infrastructures.
Cependant, au-delà des aspects purement techniques, les ouvrages d’écoulement doivent également s’inscrire dans une perspective de développement durable et de gestion optimale des ressources. La gestion des eaux pluviales, notamment, nécessite l’intégration de systèmes de rétention et de déviation des eaux pour prévenir les inondations et minimiser l’impact sur les infrastructures existantes. Les bassins de retenue et les déversoirs d’orage représentent à cet égard des solutions ingénieuses pour stocker temporairement les excès d’eau et les évacuer progressivement, tout en tenant compte des capacités des stations de traitement.
De plus, au fur et à mesure que l’urbanisation avance et que les conditions climatiques évoluent, la conception des ouvrages d’écoulement doit s’adapter en incorporant des techniques de gestion alternative des eaux pluviales (GAEP). Ces techniques, qui incluent l’utilisation de surfaces perméables, la création de bassins de rétention, et la végétalisation des toitures, non seulement contribuent à la réduction des volumes à traiter par les réseaux d’assainissement mais favorisent également la recharge des nappes phréatiques et l’amélioration de la qualité de vie urbaine.
Il convient également de noter que la construction de ces infrastructures doit se faire dans le respect des normes établies, en utilisant des matériaux de haute qualité certifiés par des organismes reconnus.
Au-delà de leur rôle fonctionnel, ces infrastructures doivent être vectrices de développement durable, contribuant ainsi à la résilience des villes face aux aléas climatiques et à la préservation des ressources environnementales. C’est dans cette optique qu’elles peuvent véritablement jouer un rôle central dans la construction des villes de demain, alliant efficience hydraulique, gestion raisonnée des ressources et amélioration du cadre de vie.
Les thèmes suivants vont être abordés dans cet article :
-
conception des réseaux d’assainissement ;
-
types de réseaux ;
-
gestion des eaux pluviales ;
-
formes et dimensionnement des canalisations ;
-
durabilité et efficacité des infrastructures ;
-
développement durable et résilience urbaine ;
-
innovations et techniques modernes.
MOTS-CLÉS
assainissement hydrologie hydraulique urbaine eaux résiduaires Déversoir d'orage Réseaux d’eau bassin de rétention
DOI (Digital Object Identifier)
Cet article fait partie de l’offre
Travaux publics et infrastructures
(82 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Des modules pratiques
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Présentation
1. Construction des ouvrages d’écoulement
1.1 Forme des ouvrages d’écoulement
La forme des canalisations d’écoulement est choisie en fonction de plusieurs facteurs, notamment le débit attendu, la facilité de construction et d’entretien, et l’utilisation efficace de l’espace.
Les tuyaux de petit diamètre sont généralement circulaires (cf. figure 1) parce qu’ils sont faciles à fabriquer, à installer, et ils occupent un espace minimal tout en minimisant le matériau requis pour leur construction. La section transversale circulaire est aussi très efficace pour résister aux pressions internes et externes. Pour ces raisons, la forme circulaire est souvent privilégiée pour les canalisations d’égout domestiques et autres petits systèmes de drainage.
La forme ovoïde (cf. figure 1), en revanche, est traditionnellement utilisée pour les canalisations de plus grand diamètre, comme certains égouts urbains ou collecteurs. La caractéristique unique de la section ovoïde est qu’elle permet de maintenir une vitesse d’écoulement plus élevée à faible charge hydraulique, ce qui est bénéfique pour l’autocurage de la canalisation. Lorsque le débit est faible, l’eau s’écoule dans la partie inférieure plus étroite de l’ovoïde, augmentant ainsi la vitesse d’écoulement et réduisant le risque de dépôt. Lorsque le débit augmente, la partie plus large de l’ovoïde sert à accueillir l’augmentation du volume d’eau.
Les ouvrages plus importants nécessitent des considérations plus complexes en matière de gestion des débits variables et de l’entretien sur le long terme. Par conséquent, malgré le coût de construction potentiellement plus élevé et la complexité, la forme ovoïde ou d’autres formes non circulaires peuvent être privilégiées pour optimiser le fonctionnement de ces systèmes.
-
Pour les têtes de réseau, il est impossible d’ajuster le diamètre en fonction du débit en raison d’une pente qui est essentiellement contrainte par la topographie. Les diamètres minimums sont fixés dans le but de prévenir tout risque de blocage :
-
0,30 mètre pour l’évacuation des eaux de pluie ;
-
0,20 mètre pour les eaux usées.
Le diamètre...
-
TEST DE VALIDATION ET CERTIFICATION CerT.I. :
Cet article vous permet de préparer une certification CerT.I.
Le test de validation des connaissances pour obtenir cette certification de Techniques de l’Ingénieur est disponible dans le module CerT.I.
de Techniques de l’Ingénieur ! Acheter le module
Cet article fait partie de l’offre
Travaux publics et infrastructures
(82 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Des modules pratiques
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Construction des ouvrages d’écoulement
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - ADIVET, CSFE, SNPPA, UNEP - Règles professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées - (2007).
-
(2) - SABER (A.A.) - Étude comparative des méthodes de calcul des réseaux d’assainissement. - Mémoire de Master. Faculté des Sciences et de la technologie (FST) (2019). PDF disponible en ligne http://archives.univ-biskra.dz/bitstream/123456789/14944/1/arbid_ahmed_saber.pdf
-
(3) - ARENE Ile-de-France - Gestion des eaux pluviales - (2011).
-
(4) - ARNAUD (P., L.J.) - Cartographie de l’alea pluviographique de la France. - Montpellier (2005).
-
(5) - ASHLEY (R.M.), BERTRAND-KRAJEWSKI (J.-L.), HVITVED-JACOBSEN (T.) - Solids in Sewers. - IWA publishing (2004).
-
(6) - ASTEE - Guide...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
-
Assainissement des agglomérations – Principe généraux et Effluents présents.
-
Traitement des eaux résiduaires des agglomérations – Concepts, relèvement et prétraitements.
-
Traitement des eaux résiduaires urbaines – Filières intensives.
-
Traitement des eaux résiduaires des agglomérations – Filières extensives et traitements tertiaires.
-
Technique et gestion de l’assainissement non collectif – Réglementation et prétraitement.
NORMES
-
ouvrages d´assainissement – Titre I : réseaux - Fascicule n° 70 -
-
ouvrages d´assainissement – Titre II : ouvrages de recueil, de restitution et de stockage des eaux pluviales - Fascicule n° 70 -
-
Équipement d´installations de pompage pour réseaux d’évacuation et d’assainissement - Fascicule 81-1 -
-
mise en œuvre et essai des branchements et collecteurs d’assainissement - NF EN 1610 -
-
réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments : - NF EN 752 -
-
réseaux sous vide à l’extérieur des bâtiments - NF EN 1091 -
-
réseaux sous pression à l’extérieur des bâtiments - NF EN 1671 -
-
canalisations...
ANNEXES
Directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
Circulaire du 15 février 2008 relative à l’application de l’arrêté du 22 juin 2007.
Circulaire interministérielle no 77-284/ INT du 22 juin 1977.
L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et leurs établissements publics de coopération délimitent « les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement », ainsi que « les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement ».
HAUT DE PAGECet article fait partie de l’offre
Travaux publics et infrastructures
(82 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Des modules pratiques
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
 QUIZ ET TEST DE VALIDATION PRÉSENTS DANS CET ARTICLE
QUIZ ET TEST DE VALIDATION PRÉSENTS DANS CET ARTICLE
1/ Quiz d'entraînement
Entraînez vous autant que vous le voulez avec les quiz d'entraînement.
2/ Test de validation
Lorsque vous êtes prêt, vous passez le test de validation. Vous avez deux passages possibles dans un laps de temps de 30 jours.
Entre les deux essais, vous pouvez consulter l’article et réutiliser les quiz d'entraînement pour progresser. L’attestation vous est délivrée pour un score minimum de 70 %.
Cet article fait partie de l’offre
Travaux publics et infrastructures
(82 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Des modules pratiques
Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses