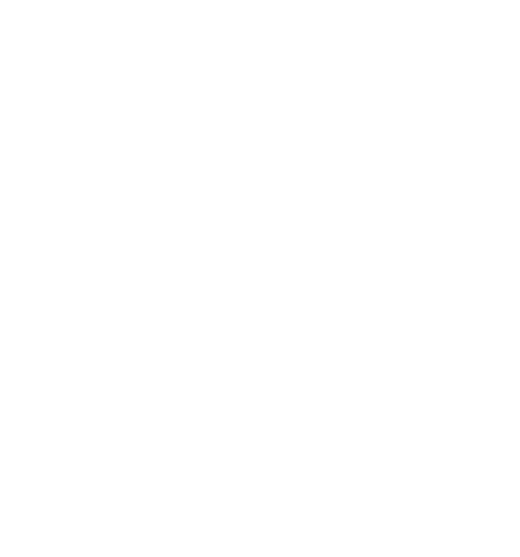Présentation
Auteur(s)
-
Bernard GARNIER : Chef du Service Projets à la société MÉTRAVIB RDS
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l’articleINTRODUCTION
La suspension élastique des machines pour réduire la transmission des vibrations indésirables à leur environnement est devenue une pratique courante, tout comme le montage souple des systèmes fragiles ou sensibles aux vibrations afin de mieux les protéger. La mise en œuvre de ces dispositifs pourrait sembler assez simple, dès lors qu’on suit bien les indications des constructeurs ; et pourtant nombreux sont les cas qui requièrent une attention particulière pour éviter des résultats malencontreux, allant jusqu’à des usures ou des ruptures prématurées.
Pour résumer les facteurs qui conduisent à ce regain d’attention lors du choix d’une isolation antivibratoire ou antichoc, on citera en particulier :
-
la volonté d’alléger et de réduire la taille des machines tout en accroissant leur puissance, ce qui amène les constructeurs à choisir des vitesses de rotation plus rapides, des carters et des arbres moins rigides, des bâtis moins surdimensionnés ;
-
la volonté de décliner des gammes standardisées de moteurs, de boîtes et de transmissions, d’accouplements, de génératrices, de pompes, etc., ce qui multiplie les possibilités de combinaisons lors d’une mise en groupe sans que le constructeur ait pu toutes les valider sur le plan dynamique et vibratoire, d’où des configurations parfois délicates à opérer ;
-
une volonté de modularité et de souplesse d’aménagement des ateliers de production, ce qui va amener les utilisateurs à implanter des instruments de contrôle ou des bureaux au plus près de certaines machines, donc à contrôler et réduire davantage les sollicitations vibro-acoustiques qu’elles génèrent, ou à minimiser l’interférence de diverses unités de production autrefois disjointes ;
-
une préoccupation d’ergonomie et de protection des travailleurs, ce qui, après avoir imposé le port de protections individuelles ressenti souvent comme inconfortable, impose maintenant de spécifier des niveaux acoustiques ambiants dans les ateliers directement acceptables sans pour autant que des systèmes trop complexes de capotages et de mise en cabines ne gênent les flux de production ni les interventions de maintenance.
Une isolation antivibratoire bien conduite peut répondre à tout cela, moyennant l’application attentive des concepts et méthodes détaillés et illustrés dans le présent article et dans l’article , qui abordent successivement :
-
Définitions et principes physiques ;
-
Solutions technologiques et industrielles.
DOI (Digital Object Identifier)
CET ARTICLE SE TROUVE ÉGALEMENT DANS :
Accueil > Ressources documentaires > Environnement - Sécurité > Bruit et vibrations > Vibrations en milieu industriel, mesures, surveillance et contrôle > Isolation antivibratoire et antichoc - Définitions. Principes physiques > Suspension antichoc d’un objet rigide
Cet article fait partie de l’offre
Fonctions et composants mécaniques
(215 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Présentation
6. Suspension antichoc d’un objet rigide
La physique de base et la conception générale d’une suspension antichoc ne diffèrent pas dans leurs principes de celles d’une suspension antivibratoire ; mais il y a au moins deux points tout à fait spécifiques :
-
la description des sollicitations couple cette fois les aspects fréquentiels et temporels et a souvent un caractère plus ou moins probabiliste ;
-
l’information requise est cette fois conjointement le choc résiduel transmis à l’équipement (valeur crête de l’accélération maximale) et le débattement maximal de la suspension ; la conception doit toujours trouver un compromis entre ces deux paramètres, alors que le choix des supports est dicté en premier lieu par le débattement que l’on souhaite permettre.
6.1 Physique du choc
Le choc de deux objets élastiques est assez simple à décrire : en effet, animés de leurs vitesses initiales à l’exclusion de toute autre force extérieure, les deux objets échangent de la quantité de mouvement, l’énergie cinétique globale étant conservée. On parle de choc dur, s’il n’y a aucune absorption d’énergie, et dans ce cas chaque masse repart avec une nouvelle vitesse, ou de choc mou, si les deux objets se lient au cours du choc pour ne plus former qu’un seul solide animé d’une nouvelle vitesse.
Si l’objet 1 est seul en mouvement, et impacte un objet 2 immobile, on établit facilement les vitesses après le choc :
-
pour un choc dur, en notant v 1 et M 1 la vitesse et la masse de l’objet impactant, M 2 la masse de l’objet impacté et
les vitesses après le choc :
TEST DE VALIDATION ET CERTIFICATION CerT.I. :
Cet article vous permet de préparer une certification CerT.I.
Le test de validation des connaissances pour obtenir cette certification de Techniques de l’Ingénieur est disponible dans le module CerT.I.
de Techniques de l’Ingénieur ! Acheter le module
Cet article fait partie de l’offre
Fonctions et composants mécaniques
(215 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
Suspension antichoc d’un objet rigide
Cet article fait partie de l’offre
Fonctions et composants mécaniques
(215 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive
 QUIZ ET TEST DE VALIDATION PRÉSENTS DANS CET ARTICLE
QUIZ ET TEST DE VALIDATION PRÉSENTS DANS CET ARTICLE
1/ Quiz d'entraînement
Entraînez vous autant que vous le voulez avec les quiz d'entraînement.
2/ Test de validation
Lorsque vous êtes prêt, vous passez le test de validation. Vous avez deux passages possibles dans un laps de temps de 30 jours.
Entre les deux essais, vous pouvez consulter l’article et réutiliser les quiz d'entraînement pour progresser. L’attestation vous est délivrée pour un score minimum de 70 %.
Cet article fait partie de l’offre
Fonctions et composants mécaniques
(215 articles en ce moment)
Cette offre vous donne accès à :
Une base complète d’articles
Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques
Des services
Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources
Un Parcours Pratique
Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses
Doc & Quiz
Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive