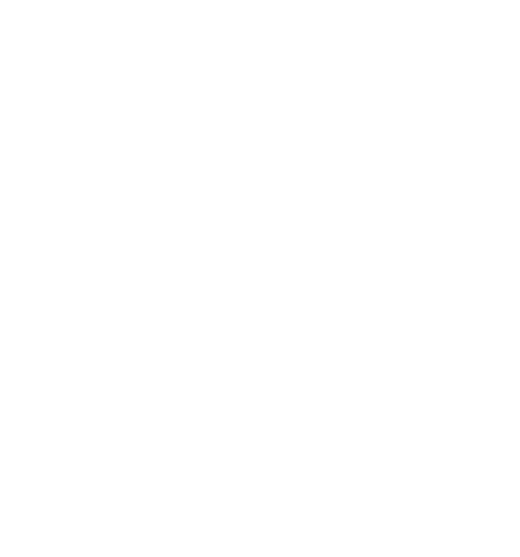- Article de bases documentaires
|- 10 avr. 2008
|- Réf : BM6112
Pour être opérationnel, un automate doit contenir les trois fonctions de la chaîne d’information : l’acquisition, le traitement et la communication. Ce système possède ensuite la capacité de coordonner une succession d’actions, pour peu que les constituants soient câblés et programmés de manière à réaliser le fonctionnement attendu. Cet article a pour objet de détailler les technologies inhérentes à la chaîne d’information et de présenter les différents composants d’automatisation y participant. La connaissance des notions de base de la gestion des procédures de marches et d’arrêts est incontournable, tout comme la normalisation des symboles pour l’élaboration des schémas de circuits pneumatiques.
- Article de bases documentaires
|- 10 mars 2009
|- Réf : S7252
Depuis leur première définition en 1962 par Carl Adam Petri, les réseaux de Petri sont devenus un paradigme puissant de modélisation et d'analyse, tant dans le monde industriel que dans les laboratoires de recherche. Enseignés dans les écoles d'ingénieurs et les universités, devenus en 2004 norme internationale (ISO/IEC-15909-1) sur les aspects dits « haut niveau », ils sont maintenant largement diffusés et de nombreuses études industrielles utilisent cet outil dans un objectif de conception et/ou d'exploitation de systèmes automatisés. La complexité croissante de nos systèmes de production, notamment dans le domaine manufacturier, a provoqué un appel de la part des concepteurs et des utilisateurs de systèmes discontinus. Le succès du GRAFCET est dû à ce besoin nouveau d'un outil capable d'exprimer les deux grandes caractéristiques des systèmes séquentiels : le parallélisme et la synchronisation. On sait cependant aujourd'hui que la conception et l'exploitation des systèmes de production manufacturiers, pour ne prendre que cet exemple, requièrent des modèles plus riches en information et plus concis que le GRAFCET, aux fins d'analyse, de simulation et de commande. La conception ou la modification d'une installation industrielle peuvent se résumer en quatre phases : la spécification des fonctions qui la composent et de leurs interactions ; l'analyse ou la validation de la description obtenue ; la simulation qui complète la connaissance du système projeté et permet un dimensionnement et une évaluation de ses performances ; l' exploitation et la maintenance . Chacune de ces phases repose sur l'utilisation d'un modèle, donc d'un langage. Trop souvent, les outils de modélisation utilisés ne s'appliquent qu'à l'une ou l'autre de ces phases. Dès lors, le passage d'une étape à la suivante ou le retour en arrière, souvent nécessaire dans cette démarche de conception, entraînent une perte d'acquis et l'introduction d'erreurs, d'ambiguïtés pourtant levées dans la phase précédente. La conception de systèmes qui, de plus en plus, doivent pouvoir s'adapter facilement aux exigences de la production suppose l'utilisation de modèles communs aux différentes étapes de la vie d'une application industrielle. Les réseaux de Petri se proposent de jouer ce rôle.
- Article de bases documentaires
|- 10 déc. 2010
|- Réf : S8015
Composant majeur des systèmes automatisés de production, l'automate programmable industriel (API) s'est vendu à des millions d'exemplaires. L'article s'efforce d'abord de définir l'API par ses caractéristiques dominantes, en premier lieu la résistance à l'environnement industriel. Les éléments constitutifs de tout API, processeur, mémoire, entrées/sorties sont passés en revue, ainsi que les fonctions de base, les langages spécifiques, et les fonctions particulières, dites fonctions métier. La communication industrielle, intégrant l'API dans un système global de traitement de l'information, et la sécurité, celle de l'API lui-même et celle qu'il peut contribuer à garantir, sont ensuite examinées. Un exemple de mise en oeuvre dans le domaine manufacturier, en association à des PC et des robots, concrétise les notions présentées et illustre l'adaptation de l'API à la fois aux techniques de pointe et à des matériels de conception plus ancienne.
- Article de bases documentaires : FICHE PRATIQUE
- |
- 24 mars 2020
- |
- Réf : 1679
Les outils classiques de gestion et de présentation de l’information tels que les tableurs, les graphiques, voire le texte et l’image, fixe ou animée, restent, par définition, linéaires. De plus, chacun ne présente qu’une seule dimension du sujet traité (chiffrée, synthétique, descriptive, etc.). Les diagrammes de Gantt et graphes de Pert apportent quelques compléments. Pour restituer la complexité d’un projet, la carte heuristique en apporte d’autres.
Cette fiche pratique et ses outils associés donnent des points de repère sur les apports les plus courants des cartes heuristiques, à la fois dans le domaine de l’efficacité personnelle et dans celui du fonctionnement en équipe projet, en faisant la distinction entre fonctionnalités innovantes et fonctionnalités de compatibilité avec des outils tels que le diagramme de Gantt.
Gestion et pilotage du projet : les fiches pour évaluer, planifier, communiquer, capitaliser