Au sein d'un projet nommé Adapto et initié par le Conservatoire du littoral, dix sites pilotes en France ont fait l'objet de nouvelles solutions pour faire face à l'érosion côtière et aux submersions marines. Dans un contexte de changement climatique, elles consistent à s'adapter en redonnant de la mobilité au trait de côte.
Face à l’érosion côtière et aux submersions marines, la stratégie habituelle de gestion consiste à construire des ouvrages pour fixer la position du trait de côte et protéger les enjeux humains et économiques contre la mer. Sauf que dans un contexte de changement climatique, qui se manifeste par l’élévation du niveau de la mer et l’augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes, elle ne se révèle pas toujours adaptée. Initié par le Conservatoire du littoral, un projet baptisé Adapto a exploré de nouvelles solutions dites souples de gestion de la bande côtière, ou encore appelées Solutions fondées sur la nature (SFN). Dix sites pilotes ont été testés en France, représentatifs d’un panel de différents types de milieux littoraux. Ce projet, qui vient de se terminer, a bénéficié du concours financier de l’Europe à travers le programme LIFE.
« Face au recul du trait de côte et à l’élévation du niveau de la mer, il y a trois stratégies possibles, détaille Olivier Brivois, Chef de projet et ingénieur littoraliste au BRGM. La première consiste à résister en construisant des digues ou en les maintenant en l’état. La deuxième est de laisser faire et d’en subir les conséquences. Et la troisième consiste à s’adapter en redonnant de la mobilité au trait de côte et en limitant la présence d’enjeux exposés aux aléas. Cette dernière solution a été testée sur les sites sélectionnés, qui appartiennent tous au Conservatoire du littoral, et qui ont la particularité d’être situés sur des zones principalement naturelles ou agricoles. Ce type de gestion est moins adapté aux villes côtières, car il faut protéger des habitations ou des activités économiques, et dès lors la digue devient incontournable. »
Reconnecter, partiellement ou totalement, un polder à la mer
Les polders, ces espaces gagnés sur la mer par l’homme, ont représenté la majorité des sites étudiés. La baie de Lancieux sur la côte nord de la Bretagne, à proximité de Saint-Malo, est l’un de ces sites progressivement gagné sur la mer, avec la création au fil des siècles des polders de Lancieux et de Ploubalay. Historiquement, la digue protégeant le polder de Ploubalay a plusieurs fois rompu, entraînant des submersions marines et son état actuel montrait localement de fortes dégradations. Et finalement, elle s’est rompue en 2020, au cours du projet. Il a été décidé de reconnecter ce polder à la mer et de ne pas réparer la digue, ce qui a modifié totalement le milieu naturel. Toute la végétation de type prairie a disparu pour laisser la place au développement de prés-salés et le conservatoire a racheté une maison, qui risquait d’être envahie par les eaux. Une digue rétro-littorale a également été construite dans la partie sud de l’ancien polder afin de protéger une route départementale.
« Au préalable, nous avons réalisé des modélisations hydrodynamiques pour anticiper ce qui allait se produire, et rajouté 20 cm au niveau moyen de la mer à l’horizon 2030 et 40 cm à l’horizon 2050, pour évaluer les effets du changement climatique. Un travail pédagogique a aussi été réalisé auprès de la population et des élus locaux pour les rassurer. Nous leur avons rappelé qu’historiquement, le trait de côte a toujours bougé, même si cela ne se voit pas forcément à l’échelle d’une vie humaine. Nous avons produit des vidéos à partir des simulations numériques pour leur montrer visuellement jusqu’où allait s’arrêter la submersion marine. Étant donné que dans les siècles à venir, le niveau de la mer va s’élever de plusieurs mètres, la solution retenue n’est envisageable qu’à moyen terme. D’ici à la fin du siècle, et suivant l’élévation du niveau marin, il faudra à nouveau se reposer des questions sur la gestion et l’adaptation de ces territoires. »
Une dune plus résiliente face au changement climatique
Cette stratégie adaptative, consistant à reconnecter, partiellement ou totalement, un polder à la mer a aussi été envisagée sur d’autres sites du projet. C’est par exemple le cas au Marais de Brouage, sur la côte Atlantique, en Charente-Maritime, puisque là encore, la digue protégeant les terrains du Conservatoire du Littoral a rompu en fin d’année 2017 et n’a pas été reconstruite depuis. « La réfection ou construction d’une digue littorale peut coûter de plusieurs centaines de milliers d’euros à plusieurs millions par kilomètre, cela signifie que construire des ouvrages en retrait de longueur réduite pour protéger localement certains enjeux coûte beaucoup moins cher, analyse l’expert du BRGM. Nous avons encore peu de recul sur la dépoldérisation, mais si des prés-salés se développent au sein de la zone reconnectée, ils vont modifier la rugosité du sol et ainsi dissiper une partie de l’énergie des courants et des vagues, limitant ainsi les sollicitations subies par les ouvrages de second rang. Ce type d’écosystème présente aussi un fort taux de séquestration du CO2 et est aussi, écologiquement plus intéressant pour de nombreuses espèces (zone de frayère et de nourricerie pour certaines espèces d’oiseaux et de poissons, zone de refuge… »
Le projet Adapto s’est aussi intéressé à des sites dunaires, notamment celui du Petit et Grand Travers, situé sur la côte méditerranéenne, à proximité de Montpellier. Les dunes ont en effet pour fonction de protéger les zones littorales contre la submersion marine. Naturellement, elles ont tendance à s’éroder et à reculer en hiver lors des tempêtes et à se reconstituer en été par temps calme. Or, dans ce cas précis, la gestion passée a consisté à limiter cette résilience, puisqu’une route avait été construite sur cette dune, ainsi que des parkings aux abords. Le site subissait par ailleurs les multiples piétinements des riverains et des touristes. « La stratégie retenue ici a consisté à redonner de la mobilité à cette dune en détruisant la route, et en construisant une autre derrière la dune, révèle Olivier Brivois. Le conservatoire a limité l’accès au site et créé des cheminements dédiés pour permettre à la végétation de pousser afin de favoriser l’accumulation du sable et stabiliser la dune. Des ganivelles, ce sont ces lattes de bois verticales que l’on plante dans le sol, ont également été posées dans le but de favoriser l’accumulation de sable et permettre un engraissement de la dune par le transport éolien. Il a fallu 10 à 15 ans au Conservatoire du Littoral pour faire accepter et mener à bien ce projet, mais aujourd’hui, cette dune présente une meilleure résilience face au changement climatique et aux tempêtes.»




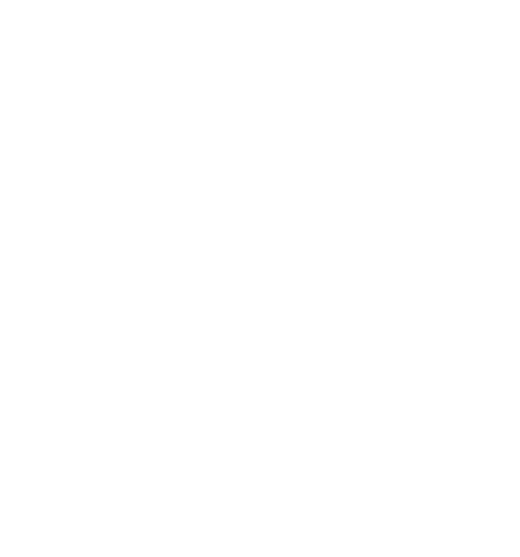















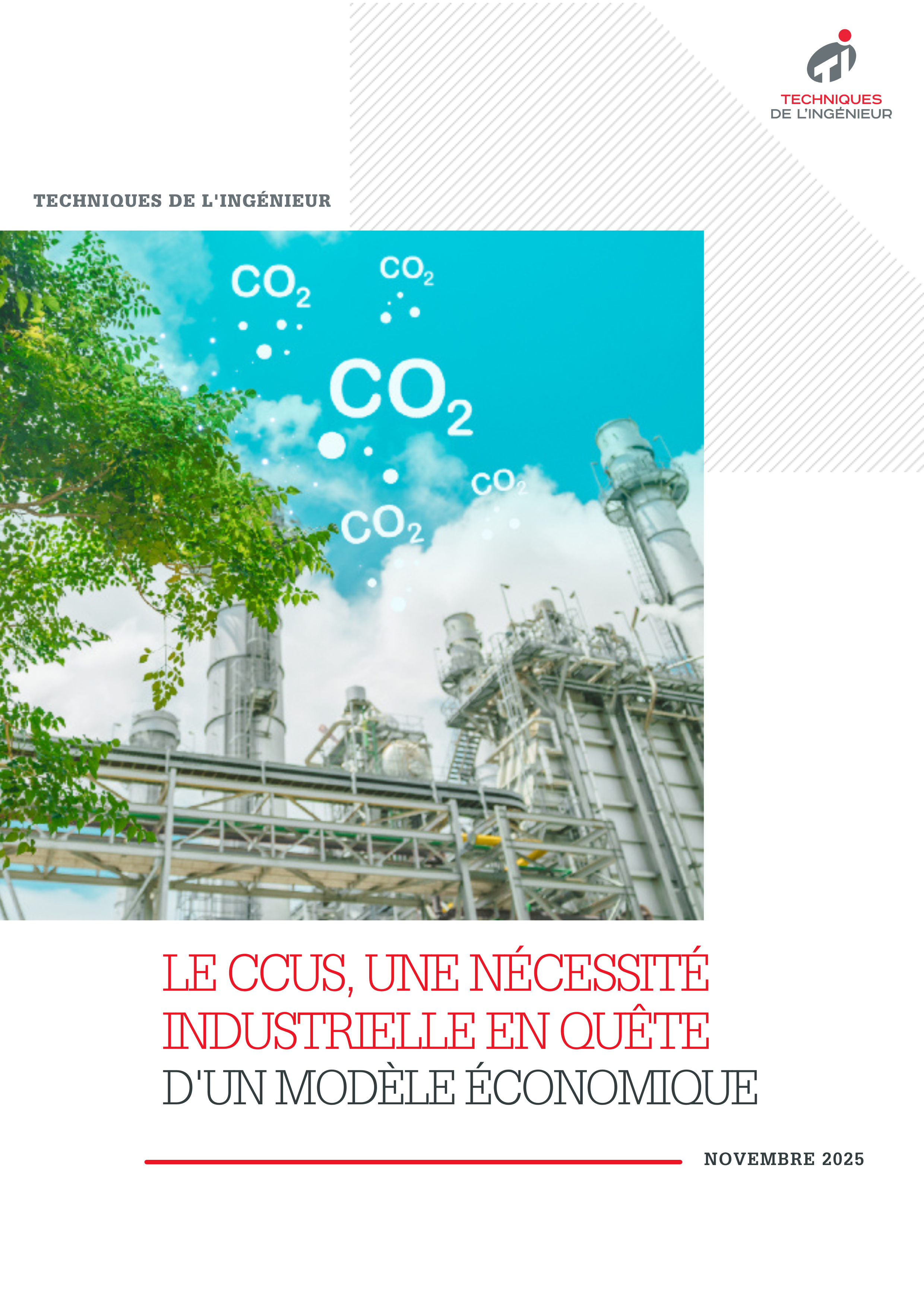


Bonjour
Comment arrêter l’érosion de la mer; il faudrait au lieu de construire une digue, creuser un fossé le long de la côte comme ceux se trouvant autour des châteaux forts, l’eau de la mer qui se trouverait dans le fossé, serait par gravitation dirigée vers une usine de désalinisation pour obtenir l’eau douce qui pourrait être utilisée pour l’irrigation ou la consommation. L’érosion de ce fait s’arrêterait au niveau du fossé et l’eau de la mer serait donc récupérée en prévision d’une sécheresse.
Le but du fossé, c’est de récupérer l’eau de mer lors des marées montantes afin de l’évacuer vers une usine de dessalage qui se trouverait en partie plus basse que le niveau de la mer. La profondeur du fossé aura une dimension appropriée pour recevoir toute l’eau de la marée montante, le fossé aura une pente pour acheminer l’eau vers l’usine de traitement. L’eau serait stockée après traitement dans des bassins pour une utilisation ultérieure.
Je pense que le fossé devrait se trouver à une distance 2 fois plus grande de la limite marée basse que de la limite marée haute pour éviter que l’eau marée haute ne stagne dans le fossé et s’évacue rapidement vers l’usine de dessalage.Cette solution éviterait ainsi l’érosion et les dégradations du littoral et des habitations qui se trouveraient à proximité de la mer … elle éviterait également la construction des digues qui sont avec le temps détériorées par l’érosion.
Je sais que vous êtes certainement des connaisseurs plus avisés que moi sur le mouvement de la mer, le cycle des marées et les conséquences sur le littoral, mais j’espère peut-être contribuer à échafauder un début de solution plausible pour contenir la montée de la mer due au réchauffement climatique.
Mème si cette solution vous paraît farfelue, utopique, essayez avec des personnes compétentes d’étudier les avantages et la faisabilité d’une telle réalisation … merci pour votre attention.
Cordialement
Daniel joux 0641031789
Réagissez à cet article
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.
Inscrivez-vous !
Vous n'avez pas encore de compte ?
CRÉER UN COMPTE