Depuis le début de la crise sanitaire que nous connaissons, la souveraineté alimentaire française a été mise à l'épreuve. De la ruée dans les magasins observée début mars à la gestion d'une situation inédite depuis le début du confinement, la filière agricole résiste comme elle peut.

La filière fruits et légumes frais en est un exemple, avec ses problématiques propres. Laurent Grandin est président de l’Interprofession des fruits et légumes frais, INTERFEL. Elu depuis la fin de l’année 2018, il a accepté de répondre aux questions de Techniques de l’Ingénieur sur la gestion de la crise et sur les défis qui sont ceux de la filière actuellement. Une crise qui est loin d’être terminée et qui aura des répercussions économiques à moyen terme, ce qui constitue un autre défi qu’il va falloir relever. Interview réalisée le 14 avril 2020.
Techniques de l’Ingénieur : Comment la filière fruits et légumes a-t-elle réagi face à la crise sanitaire que nous connaissons depuis le mois de mars ?
Laurent Grandin : La filière fruits et légumes est dans un cas un peu particulier dans le contexte actuel, puisqu’elle échappe au confinement. En ce qui concerne les fruits et légumes, l’autosuffisance est d’à peu près 50% en France. Cela veut dire que 50% des produits viennent d’ailleurs. Cela concerne les agrumes par exemple, que l’on ne peut pas produire sous nos latitudes, ainsi que tous les fruits tropicaux.
Néanmoins, il faut regarder les choses en face. Nous avons perdu ces 20 dernières années près de 50% de notre production en fruits. La raison est claire : le manque d’harmonisation européenne fait que, malgré une productivité qui est loin d’être mauvaise, nous ne sommes plus compétitifs par rapport à un certains nombre de nos voisins. Aujourd’hui certains pays européens bénéficient d’un coût de main d’oeuvre très bas, avec une productivité comparable à la nôtre. C’est pour cette raison qu’Interfel plaide pour une harmonisation européenne aux niveaux fiscal, social et environnemental. On ne peut pas continuer à évoluer dans un espace commercial ouvert, mais au sein duquel les distorsions de concurrence sont telles que celles que l’on observe aujourd’hui.
Quelles dispositions ont été prises pour soutenir la filière avant la crise sanitaire ?
La filière, qui comme je l’ai dit fournit 50% des fruits et légumes dans l’hexagone, a bénéficié de dispositions particulières comme le CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) ou le TODE (Travailleurs Occasionnels Demandeurs d’Emploi) pour les travailleurs saisonniers. Néanmoins, le maintien du dispositif tel qu’il est aujourd’hui aboutira selon nous, dans une dizaine d’années, à une souveraineté alimentaire tournant autour de 25 à 30% pour les fruits et légumes, au mieux.
Il ne s’agit pas ici de remettre intégralement en cause la logique libérale des échanges à l’oeuvre aujourd’hui. D’ailleurs notre filière est en partie composée d’importateurs, d’exportateurs… nous ne sommes pas « anti-commerce ».
Mais la logique que nous essayons de maintenir dans l’interprofession n’est pas celle d’un système ultralibéral ouvert au sein duquel chacun doit se débrouiller. Il s’agit plutôt de trouver des espaces de complémentarité pour avoir à la fois une alimentation de qualité, accessible, et diversifiée.
Cette complémentarité que vous évoquez est-elle compatible avec les réglementations européennes ?
Aujourd’hui les exigences pour bénéficier d’une alimentation – au niveau des fruits et légumes – saine et équilibrée sont incompatibles avec les règles du marché telles qu’on les connaît aujourd’hui. Encore une fois je tiens à le préciser : nous ne jetons pas la pierre à des opérateurs italiens ou espagnols par exemple qui bénéficient d’une main d’oeuvre beaucoup moins chère qu’en France. Nous avons d’ailleurs beaucoup d’échanges avec les filières de ces pays au niveau continental.
L’harmonisation au niveau européen est nécessaire, c’est ce que nous ne cessons de plaider. D’ailleurs beaucoup de mesures qui sont prises unilatéralement – ce que l’on appelle la surtransposition – constituent une pratique que nous réprouvons totalement. Cette volonté individuelle de chaque pays à vouloir tirer son épingle du jeu est d’ailleurs ce qui pour nous a amené l’agriculture dans l’impasse dans laquelle elle se trouve aujourd’hui.
L’état des lieux que vous dressez est-il le même pour toutes les filières agricoles ?
Non. Les problématiques sont différentes selon les filières. Si on s’intéresse par exemple aux filières céréales ou vins, qui sont très exportatrices, les problèmes de concurrence se posent différemment.
En ce qui concerne notre filière, le problème se pose plus sur l’arboriculture que sur les légumes, pour lesquels une grande partie du travail peut être mécanisé. A contrario la production arboricole nécessite beaucoup de main d’oeuvre. C’est la raison pour laquelle nous restons compétitifs sur tout ce qui est légumes racines.
Que préconise Interfel ?
Ce que nous considérons comme cohérent, c’est d’avoir un espace dans lequel les structures seraient complémentaires – je le répète – plutôt qu’en affrontement perpétuel sur les marchés. Si nous considérons que la souveraineté alimentaire est un des fondements de l’Union Européenne, les domaines agricoles et alimentaires devraient alors échapper, de notre point de vue, au champ de la concurrence, pour se régler d’une autre manière. C’est d’ailleurs un peu ce que dit le président de la République. Nous sommes pour que cela se mette en place dans un cadre européen, mais il ne faut pas que viennent s’ajouter à chaque fois des dispositions spécifiques à la France, qui créent des handicaps supplémentaires au sein d’un contexte qui n’est déjà pas simple à la base.
Quelles sont les options pour sortir de la logique économique actuellement à l’oeuvre ?
Il y en a plusieurs. La tendance à la relocalisation des productions par exemple, même si elle crée une résistance certaine et un effondrement à certains endroits.
La loi Egalim permet aussi une montée en gamme, à travers des conversions qualitatives qui correspondent mieux aux attentes citoyennes. Maintenant, il va être important de voir, dans un contexte post crise sanitaire, qui sera suivi, à n’en pas douter, d’une crise économique, quel sera l’environnement d’achat. Car qui dit montée en gamme dit également montée en prix. Et il ne s’agit pas de proposer, à la sortie de la crise que nous vivons, des produits qui deviennent inaccessibles aux consommateurs.
Une solution que nous avions également préconisée depuis deux ans était de pouvoir ouvrir, en dérogation du droit de la concurrence, les marchés publics des produits frais. Cette disposition permettrait de protéger des production et d’installer une dynamique locale sans compromettre l’ensemble des échanges. D’ailleurs les élus avec lesquels nous avions alors évoqué cette hypothèse l’avaient accueillie plutôt favorablement.
Revenons à la crise actuelle. Quelles sont les problématiques en ce qui concerne la main d’oeuvre nécessaire au maintien de l’activité dans les semaines et mois à venir ?
Le problème lié à la main d’oeuvre a été en partie résolu pour la période de début de crise : A été obtenu auprès du gouvernement pour la filière agroalimentaire de bénéficier de contrats spécifiques en dérogation du droit classique. En clair, il est possible de proposer des CDD à des gens qui sont en chômage technique et ayant un CDI à la base. Le tout avec des délais très courts de prévenance, ce qui permet aux employeurs de franchir le pas plus facilement. Les premières tensions sur la main d’oeuvre ont été en partie levées comme cela, et notamment grâce au site Wizifarm, qui a facilité la mise en relation. Cependant, il s’agissait alors de trouver 40 000 personnes. A terme, il va falloir trouver 200 000 personnes, et cela constitue une inquiétude certaine. D’autant plus que la date du 11 mai se rapproche et que certaines personnes vont peut-être reprendre leur travail. Aussi le travail agricole est difficile, nous l’éprouvons chaque année avec les agences pour l’emploi : 75% des volontaires se désistent après la première semaine de travail.
Quelles sont les options ?
Nous comptons beaucoup, comme chaque année, sur la main d’oeuvre étrangère, mais comme vous pouvez l’imaginer, à ce niveau là c’est l’incertitude la plus totale, et rien n’a été tranché au niveau de l’Etat pour le moment.
Une piste serait de s’appuyer, comme cela se fait actuellement en Espagne et en Italie, sur les réfugiés sans autorisation de travail. Comme la plupart de ces gens sont en France depuis des année, pourquoi pas leur donner du travail en en profitant pour les régulariser.
Mais nous faisons face à une autre difficulté : les normes qui ont été établies pour loger les saisonniers obligent à doubler les surfaces habituellement consacrées, pour des questions sanitaires. Cela pose un gros problème aux producteurs.
Au milieu de tout cela, les exigences citoyennes quant à la qualité des produits agricoles sont de plus en plus pressantes… Cela est-il toujours une priorité aujourd’hui ?
Bien sûr. Nous sommes déjà très engagés sur les processus agroécologiques depuis plusieurs années notamment à traver la HVE (Haute Valeur Environnementale). La filière fruits et légumes s’est lancée dans le bio et la conversion au bio depuis longtemps, et même si nous pensons que ce n’est pas forcément « la » solution, cela en fait partie. Tout cela mis bout à bout, nous considérons que nous avons beaucoup avancé par rapport à ces attentes citoyennes, et nous essayons de communiquer sur cet état de fait le plus possible. Comme nous l’avons fait lors du dernier salon de l’agriculture par exemple.
Cela dit, beaucoup d’ONGs jouent un peu le jeu de la surenchère, en arguant que l’agriculture pourrait se passer totalement de tout traitement, alors que c’est totalement impossible aujourd’hui.
Beaucoup d’efforts sont à l’oeuvre. Les statistiques de l’année dernière transmises par l’EFSA, l’autorité européenne de sécurité des aliments, indiquent que 60% des fruits et légumes ne contiennent aucune trace de pesticides décelables. Cela ne veut pas dire que l’on n’a pas utilisé de pesticides pour la culture de ces produits, mais qu’en tout cas celle-ci a été raisonnée et ne laisse pas de traces. Il faut évidemment continuer sur cette voie et progresser encore.
Pour continuer à progresser comme vous le dites, quelles sont les priorités?
Il va falloir que l’Etat finance beaucoup plus largement la recherche appliquée. Je m’explique. La recherche académique – menée entre autres par l’INRA – est fondamentale, mais pour concrétiser les résultats de ces recherches sur le terrain jusqu’aux producteurs, il faut tester « au réel », dans plusieurs stations, les conditions de mise en oeuvre de ce qui est préconisé. Aujourd’hui, cette recherche appliquée, au niveau de la filière fruits et légumes, est financée quasiment à 100% par les professionnels.
Je vais prendre un exemple. Nous avions estimé à l’époque où cela faisait débat que pour sortir définitivement du glyphosate – inventorier les solutions, les transposer… – nous avions besoin de 30 millions d’euros. Notre budget total sur tout ce qui touche à ces sujets est de 20 millions d’euros, il y a donc un sacré différentiel à combler.
Propos recueillis par Pierre Thouverez




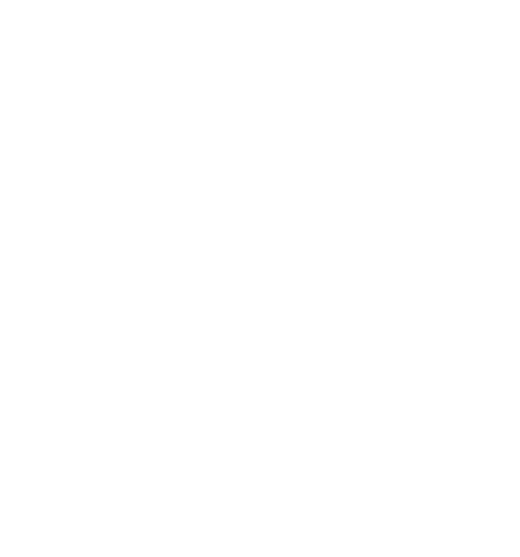


















Réagissez à cet article
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.
Inscrivez-vous !
Vous n'avez pas encore de compte ?
CRÉER UN COMPTE