Les sciences participatives fournissent aux chercheurs des données auxquelles ils n’ont pas accès par d’autres moyens. Apolline Auclerc mène des recherches au sein de l'Université de Lorraine sur la biodiversité visible des sols urbains. Pour obtenir suffisamment de données, elle s’est tournée vers les sciences participatives. Interview.
Enseignante-chercheuse et maîtresse de conférence à l’Université de Lorraine et plus précisément à l’ENSAIA, Apolline Auclerc réalise ses recherches au laboratoire sol et environnement. Son expertise se situe au niveau de la biodiversité visible des sols : vers de terre, araignées, mille-pattes, cloportes… elle se consacre donc à l’étude d’organismes visibles, et cet élément a son importance pour développer des projets de sciences participatives.
Apolline Auclerc a accepté de répondre aux questions des Techniques de l’Ingénieur, sur la finalité du projet de recherche sur la biodiversité des sols qu’elle mène, et en quoi les sciences participatives l’aident dans ce projet à grande échelle.
Techniques de l’Ingénieur : Présentez-nous le projet de recherche que vous menez actuellement autour de la biodiversité en milieu urbain.
Apolline Auclerc : Mon sujet de recherche porte sur l’étude de la biodiversité des sols en milieu urbain et dans les friches industrielles. Nous réalisons donc régulièrement des prélèvements dans ces milieux-là pour observer quel type de biodiversité est présente, comment elle évolue, quel est l’impact humain sur cette biodiversité…
A l’heure actuelle nous n’avons que très peu de données concernant la biodiversité des sols dans les milieux urbains. Les recherches que nous menons ont donc pour but premier de constituer une base de données, qui permettra par la suite de mieux connaître la biodiversité des sols en milieu urbain, et les dynamiques qui s’y développent.
C’est l’ambition de constituer cette base de données qui a fait émerger l’idée de faire appel aux sciences participatives. Cette démarche permet d’une part de sensibiliser les citoyens à la biodiversité qui les entoure, il y a donc un aspect pédagogique qui est important ; d’autre part, nous collectons des données issues d’endroits où je n’ai pas l’occasion et le temps d’aller, comme les jardins privés par exemple. Il me serait impossible d’accéder à ces données par un autre biais qu’un programme collaboratif. C’est un des points forts de ces programmes collaboratifs : la possibilité de récolter des données sur une échelle géographique et temporelle jamais vue auparavant.
Quel est le protocole mis en place pour les volontaires qui désirent participer à la collecte de données sur le projet dont vous avez la charge ?
L’idée de base est de partir d’un pot qu’on insère dans le sol, un piège Barber [portant le nom de son inventeur, le piège Barber est un récipient, à parois lisses, enfoncé dans le sol, mais dont l’ouverture touche le niveau du sol, NDLR], qui va permettre de piéger les animaux sur une durée de temps déterminée. C’est ce protocole que les participants à mon projet de recherche mettent en place. Pour éviter de tuer les animaux, ce qui est d’habitude la méthode employée pour être le plus précis possible au niveau de l’identification des espèces, nous développons des protocoles adaptés, où les animaux sont relâchés à la fin de l’expérience. Cette évolution des protocoles académiques habituels a été mise en place pour développer la participation des citoyens à ces programmes collaboratifs, car ces derniers ne sont que peu enclins à tuer systématiquement les animaux piégés. C’est ce qui nous a poussé à développer ces protocoles adaptés, et j’y vois un progrès pour tout le monde. Je pense que c’est à nous, scientifiques, de nous adapter et d’être peut-être moins exigeants sur la connaissance précise des espèces répertoriées par les volontaires, ce qui permettra d’obtenir une participation plus importante.
Parlez-nous de Jardibiodiv, l’application utilisée par les volontaires pour la récolte des données d’observations ?
L’outil s’appelle Jardibiodiv, et se présente sous la forme d’une application mobile qui permet aux participants de répertorier les espèces observées à la surface d’un sol : cela peut se faire en prenant les animaux en photo et en complétant un formulaire d’observation. Ce qu’on observe, c’est qu’il y a un réel engouement autour de ces programmes participatifs. Ce que l’on voit également, c’est que la nature des animaux à observer influe également sur le taux de participation. Évidemment, l’observation de la biodiversité en surface des sols – vers de terre, araignées… – a quelque chose de moins attrayant que celle d’autres animaux comme les oiseaux ou les papillons par exemple. C’est quelque chose qu’il faut prendre en compte, notamment au niveau du travail de sensibilisation nécessaire, qui fait désormais partie intégrante de mon travail.
L’amélioration des applications d’identification des espèces est-elle un enjeu fort pour augmenter la participation des citoyens et la qualité des données ?
Effectivement. Nous collaborons aujourd’hui avec Vigie-Nature dans le cadre d’un nouveau projet, avec un outil, QUBS, qui doit nous permettre de développer plus efficacement notre base de données, notamment photographique, pour optimiser au fur et à mesure la reconnaissance des espèces à travers l’utilisation d’applications mobiles. Cet outil permettra de ne pas tuer les animaux piégés, mais en revanche il nécessite un suivi plus contraignant, ce qui est souvent une barrière pour les participants. Par exemple, il y a beaucoup d’enseignants qui participent à notre programme, car en ce qui concerne les pièges Barber, il faut effectuer un comptage chaque semaine, ce qui correspond bien au rythme scolaire, pour que les professeurs réalisent cette activité avec leurs classes. S’il est vrai que les instituteurs sont ravis qu’on leur propose un nouveau protocole qui permet de ne pas tuer les animaux observés, leur capacité à réaliser les observations plusieurs fois par jour sur le long terme est relativement incertaine.
Les données obtenues via les programmes de recherche participatifs sont parfois critiquées pour un supposé manque de fiabilité. Qu’en pensez-vous ?
Il est vrai que cet aspect des sciences participatives fait aujourd’hui débat dans le monde scientifique. Pour beaucoup de chercheurs, seuls les personnels qui ont été formés pour cela peuvent réaliser des observations sans se tromper. Personnellement je ne vois pas les choses sous cet angle. Je suis persuadée que les protocoles que nous établissons pour les participants, ainsi que les forums de discussions mis en place, qui peuvent aider ces derniers à valider leurs identifications, sont des outils adaptés et permettent de collecter des données très utiles pour la recherche.
Ceci dit, il faut prendre en compte l’aspect spécifique de ces données. Par exemple, des photos d’identification prises dans deux jardins différents ne tiennent pas compte de la nature du sol. Et cela peut constituer une donnée importante, notamment dans le cas des jardiniers, qui traitent tous leurs sols de manières différentes. Cela constitue un biais, forcément. Il faut prendre cela en compte dans l’utilisation que l’on va faire de ces données. Pour ce qui est de mon projet de recherche actuel, à savoir établir une base de données de la biodiversité des sols urbains, inexistante à ce jour, l’enjeu est tellement important qu’il justifie qu’on soit moins exigeant scientifiquement sur la qualité des données, à mon sens.
Quels sont, selon vous, les leviers pour augmenter la participation des citoyens aux programmes de sciences participatives ?
Aujourd’hui, il nous faut développer des programmes de sciences participatives qui vont intéresser le plus largement possible de potentiels participants. Pour que ces participants soient motivés pour suivre nos protocoles sur le long terme, il faut absolument que le temps nécessaire pour réaliser ces protocoles soit limité. C’est un facteur essentiel.
Propos recueillis par Pierre Thouverez
Apolline Auclerc a donné une conférence sur « l’impact des aménagements urbains sur la biodiversité du sol », dans le cadre de la journée thématique « Le génie écologique au service des sols » organisée par Techniques de l’Ingénieur le 21 octobre 2021. Vous pouvez voir ou revoir sa présentation en cliquant sur ce lien.




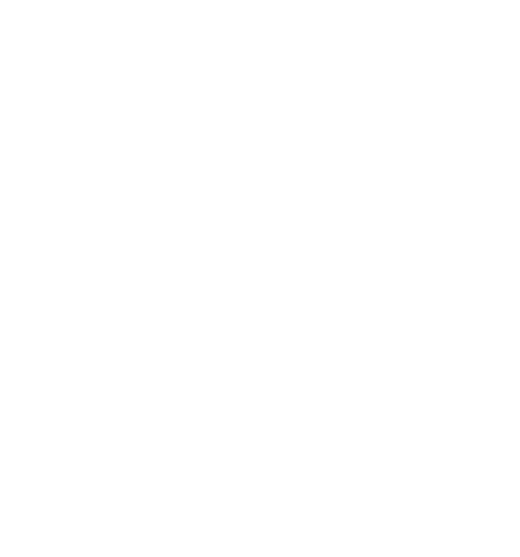


















Réagissez à cet article
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous et retrouvez plus tard tous vos commentaires dans votre espace personnel.
Inscrivez-vous !
Vous n'avez pas encore de compte ?
CRÉER UN COMPTE